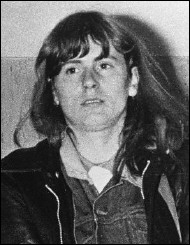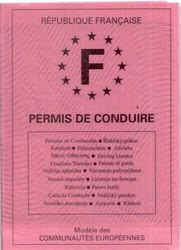Toute
représentation reproduction intégrale ou partielle faite sans le
consentement de l'auteur ou de ses ayants-droit ou ayants-cause est
illicite. Loi du 11 mars 1957, article 40 alinéas 2 et 3.Toute représentation
ou reproduction par quelque procédé que ce soit constituerait
donc une contrefaçon sanctionnée par les articles 425 et suivants du
code pénal.

|
TURNY DU XIIème au XXIème SIECLE
|
A) Du
XIIème siècle au XVIIème siècle
1) La Paroisse et la Seigneurie de Turny
Ce sont les Templiers
et plus particulièrement la
Commanderie de COULOURS qui créèrent
la Paroisse
et la Seigneurie de
Turny. ( Bénony DURANTON, annuaire de le Yonne -
année 1854 - P.400). ( Bénony DURANTON, annuaire de le
Yonne -
année 1854 - P.400). ). Un acte de donation de GUERRIN, Seigneur
de Turny, nous apporte la preuve que Turny est une Paroisse dès
1140 et
nous fait découvrir le nom du Curé de Turny de
l'époque : FROMOND (FROMOND, curé de Turny appartient
à l'ordre des Templiers ).
Les limites territoriales de cette Paroisse
sont celles qui délimitent la commune actuellement. En 1141 l'église n'existait pas.
(Construction de l'église de 1518 à
1550(Construction de l'église de 1518 à
1550). Seule une chapelle permettait la
célébration du culte. Une population suffisamment importante dans le bourg, et surtout
la présence des Templiers justifiaient l’existence de cette Paroisse. Enfin,
s’il est possible d’affirmer qu'il existait effectivement une Paroisse en 1141,
rien ne prouve qu'il n'y en avait pas avant cette date.
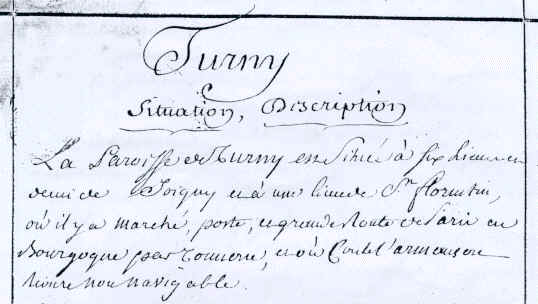
Voici
selon PICHOT, arpenteur Royal en 1784, une présentation
(Texte complet) et un plan
de
cette Paroisse
Malgré la charte de franchise,
Turny fait partie de la seigneurie, ceci n'est pas incompatible ....En 1141, le territoire
de notre commune actuelle semble être partagé par deux seigneurs (Bénony DURANTON, Annuaire de
l'Yonne - année1854 -p.397)Bénony DURANTON, Annuaire de
l'Yonne - année1854 -p.397).
L'un se dénomme GUERRIN, et porte le titre
de Seigneur de Venizy (il possédait des terres à Turny, Venizy et Chailley).
Le second se nomme Mainard et se fait
appeler Seigneur de Turny.
Le droit de ban de ce dernier était
atténué en raison de l'existence de la charte de franchise. Toutefois, son influence sur
les habitants de Turny était importante.
En effet, non seulement il conservait
certains pouvoirs sur Turny, mais son arbitraire hors du bourg était total. Il pouvait
imposer ce qu'il voulait hors du "Turris", ce qui ne pouvait être sans
conséquence dans le village.
Enfin si MAINARD et GUERRIN sont les
seigneurs les plus anciens dont on parle dans les actes divers, il est très
probable que durant des périodes antérieures d'autres seigneurs aient tenu Turny et son
territoire actuel sous leur joug. Si la création d'une Seigneurie à Turny date
effectivement de 1141, les seigneurs régnant sur la contrée portaient sans doute le nom
d'une autre localité
2)
La commune "Comugne" de Turny
En ce qui concerne
l'affranchissement de
Turny, qui remonterait également à 1141 et dont fait
état Bénony DURANTON (Annuaire de le Yonne- année
1854- P. 400), quelques explications s’imposent.
En effet, avec cet affranchissement, Turny
acquiert son indépendance et devient donc commune au sens de "Comugne".
Cette dénomination du XIIème siècle
n’a aucun rapport avec la commune actuelle qui est une
circonscription territoriale datant de la Révolution française.
Par ailleurs, seul le village de Turny
est
concerné par cet affranchissement. Le reste du territoire actuel reste sous l'emprise de deux seigneurs.
Les empreintes du passé témoignent à
l'évidence que Turny était un bourg organisé pour son autodéfense, pour sauvegarder
son indépendance.
Ses fossés, sa motte féodale, ses palissades de bois
puis ses enceintes fortifiées, murailles et tours de défense complétaient et
renforçaient le dispositif de protection contre les attaques ennemies.
On pouvait pénétrer à l'intérieur du
bourg par deux portes d'enceinte équipées de ponts-levis (Annuaire de l'Yonne - Année1854 - P.399).
L'une des portes était située à l'ouest coté Bas-Turny. La seconde à l'est,
rue du pont maillet appelée grande rue aujourd'hui en direction les Varennes.
C'est sous le règne de Louis LE GROS que
cet affranchissement fut consenti, et Turny était à l'époque l’une des premières
bourgades à accéder à cette nouvelle forme de liberté.
En effet, les toutes premières franchises
datent de 1108 environ et c'est surtout vers le XIIIème siècle que les Comugnes vont se
multiplier.
L'origine de l'apparition de ces Comugnes,
nous dit Guy FOURQUIN ( Seigneurie et féodalité au
Moyen-Age - PLJF 1970), est le résultat de
circonstances particulières qui ont contraint les seigneurs et le roi.
C'est d'abord pour attirer les
défricheurs, mais aussi par peur de voir les hommes libres de la seigneurie émigrer que
les seigneurs se sont vus dans l'obligation de consentir certains avantages.
Ils
atténuèrent les effets de leur droits
de ban par le biais des franchises concédées aux villes
et aux villages."LE BAN".était un pouvoir général
de commandement,
contraindre et punir les hommes libres.
Bien entendu, ces affranchissements
étaient rarement donnés dans un élan de pure générosité. Dans cette première
moitié du Xème siècle, les franchises étaient l'aboutissement d'un marchandage.
Les besoins en main-d'oeuvre du seigneur,
ainsi que les capitaux fournis par les bourgeois, arrivaient à convaincre le seigneur de
l'opportunité d'une charte de franchise.
Cette charte de franchise avait pour but de
fixer certains rapports entre la ville affranchie et le seigneur. Elle n’enlève pas
tous les pouvoirs du seigneur sur le bourg.
La charte négociée est importante dans le
sens où elle fixe, en termes clairs, par exemple : les droits de péage, la taille, la
tarification des amendes...
Le terme de franchise admet par définition
que "seront réputés libres, les hommes protégés de l'arbitraire seigneurial par
une charte de franchise.
A Turny les habitants étaient donc des
hommes libres (Par opposition aux serfs = esclaves).
Au XIIème siècle, être une ville
affranchie, se traduit par un statut accordé par le roi ou le seigneur, et qui permet aux
associations de bourgeois de jouir du droit de se gouverner eux-mêmes, dans certaines
limites fixées par la charte.
Ainsi le bourg possédait-il, par le biais
de ses administrateurs, une sorte de personnalité morale qui lui permettait de posséder
des biens, de recevoir des dons, et de gérer un patrimoine.
Ce statut permettait également de
constituer des milices, sorte de police interne et particulière à la ville chargée,
sous l'autorité des administrateurs, de la défendre et de régler les problèmes du
"Turris".
3)
Les Templiers à Turny
3/1 Généralités
En France, le Temple est fondé entre le
premier novembre 1119 et le 12 janvier 1120. L'emblème est un drapeau blanc symbolisant
l'innocence, frappé d'une croix rouge, le martyr. Ce nom de Templiers fut donné par
BAUDOIN II, Roi de Jérusalem, à ces gens qui défendirent la Terre Sainte, après qu'il
les eût logés près du Temple de Salomon.
Le Temple se développe dès le milieu du
XIIème siècle et s'étend dans tout le monde occidental par ses Commanderies, ses
Maisons, ses Granges et ses Fermes.
Cette organisation internationale religieuse est divisée
en provinces.
En France, il existe cinq grandes provinces avec, chacune
à leur tête, un grand commandeur. A l'intérieur de la province, le Temple s'organise en
commanderie.
L'ordre se faufile dans les mines et le
commerce. Le fer est très prisé, principalement en Bourgogne. Il est utilisé pour les
cottes de mailles.
3/2 Les Templiers à Turny
Dès la première moitié du XIIème
siècle, vers 1140, les Templiers se créèrent deux maisons. Ils sont établis à
Turny
et au Luteau
(Bénony DURANTON, annuaire de l'Yonne
- année 1850 - p.400) et possèdent aussi les
terres de Saint-Laurent (hameau proche de L'hopital). Le commandeur résidait à
Coulours.
En 1226, la maison de Turny était devenue
très puissante et possédait tout le village. Plus tard, l'église (qui n'est pas
l'église actuelle) sera construite sous l'incantation de "Santi-Mammetis de
Turniaco" par le Temple. Elle fait exception aux autres paroisses du doyenné qui
avaient pour patron fondateur de leur église l'archevêque ou le prieur du lieu.
Selon Bénony Duranton, le commandeur
percevait les dîmes à Turny dans un bâtiment attenant au presbytère.
Cette puissante organisation allait jouer
un rôle décisif dans ses différends avec l'Abbaye de Pontigny, à propos des bois de
Saint-Pierre.
De nombreux actes témoignent de
l'activité de ces Templiers à Turny. Ainsi, par un traité datant de 1226 entre
les Templiers de Coulours et l'Abbaye de Pontigny, on apprend que la maison de Turny qui
élevait des porcs pourraient en amener jusqu'à trois cents dans la forêt de
Saint-Pierre en payant deux deniers par porc ainsi que quarante grands bestiaux et trois
cents moutons.
Il est amusant de savoir qu'une bulle du
Pape Alexandre III du 5 février 1180 obligeait tous les animaux des Templiers à porter
devant leur tête la croix de l'ordre cousue sur un morceau d'étoffe. Les gardiens
devaient porter également ce symbole.
On apprend également par ce même traité
que :
"Ceux-i
pourraient, dans cette même forêt, prendre une charretée par jour de bois mort pour
brûler, de bois vif pour bâtir et faire des tonneaux et les autres vaisseaux
nécessaires en ce lieu"
La maison de Luteau, appelée
"Dou Luetel" et située entre Linant et saudurant à proximité du carrefour des
CD n°112 et CD n°120, est un don fait aux Templiers par GUI RAGOS, Sire de Chailley, en
mars 1254 (Bénony Duranton annuaire de le Yonne
– année 1854).
En 1236, ERARD DE BRIENNE accorde aux
Templiers pour leurs maisons de Turny et de Luetel (le Luteau), le droit de
pâturage dans tous ses bois jusqu'à la limite de Burs (Boeurs). Il leur accorde
également le droit de pêche dans le bief des moulins.
Par ce dernier acte, il est interdit à
Erard, à ses successeurs et aux Templiers de chasser dans le clos de vignes des Frères
de Turny. Pour cette concession, les Frères ont versé à ERARD deux cents livres.
Les Templiers avaient une vie très
organisée. Ils obéissaient à des règles strictes. A Turny, les Templiers ne vivaient
pas différemment.
Le premier lever
était à cinq heures du
matin l'été, et à six heures l'hiver. Le Templier
commence par entendre les matines
prières chantées ou récitées par les
chapelains. Ensuite, après être allé examiner
ses bêtes et son harnais, il pouvait se recoucher.
Le second lever avait lieu vers huit
heures. Les offices religieux terminés le Templier, qui n'a pas reçu d'ordre de combat
ou n'est pas de service, va réparer et appareiller son armure et son harnais, vaque aux
besoins administratifs et temporels.
Au déjeuner, les chevaliers mangent à la
première table, la seconde étant réservée aux sergents. Quand toute la commanderie est
présente, chacun récite un patenôtre. Pendant le repas, un Frère fait la lecture afin
que les autres soient nourris matériellement et spirituellement.
L'après-midi du Templier sera interrompu
par des offices de nones et des vêpres auxquels succèdent le souper, puis l'office, les
soins aux bêtes enfin le coucher.
Le voeu de pauvreté fait que toutes les
choses de la maison sont communes. Les Templiers ne possèdent rien à titre personnel.
Les Templiers en Europe accomplissaient
leur mission au cours des siècles à travers de nombreuses batailles. Néanmoins,
l'organisation du Temple était minée par la corruption, les crimes....
Afin de faire cesser ces méfaits, PHILIPPE
LE BEL fit arrêter par ordre secret tous les Templiers, le même jour dans toute la
France, le 15 octobre 1307.
A Turny, le curé Frère MICHEL qui
appartenait à l'ordre fut donc arrêté. Il abjura ses erreurs et fut absous devant le
concile provincial de SENS. Il passa au grand interrogatoire des commissaires pontificaux.
Le Pape Clément V abandonna tous les biens
des Templiers dont l'ordre fut aboli aux Frères Hospitaliers. Turny ne fait pas exception
à la règle. Le hameau de L'hopital doit l'origine de son nom à cette époque
mouvementée de l'histoire locale.
LE TEMPLE DE TURNY

Le temple
de Turny était situé au nord du village, au lieu appelé depuis l'Hôpital;
il en dépendait une chapelle, nommée la chapelle de Saint-Laurent, qui se
trouvait entre la maison du Temple et le village. C'est ce qui a fait appeler
parfois la maison de Turny, la Petite-Commanderie de Saint-Laurent.
Le fief de Turny appartenait aux Templiers, dès le commencement du XIIIe siècle.
Il comprenait alors les moulins de Venesi, « Venesi, aujourd'hui Venizy"

qui en formaient le principal revenu. Gérard
de Brienne, seigneur de Ramerupt, « dominus de Ramerici », eut plusieurs
contestations avec les frères du Temple, au sujet de leurs possessions de Turny.
Les prieurs de Sainte-Geneviève et de Saint-Eloi à Paris, choisis pour
arbitres, mirent fin à leurs débats par une transaction, laquelle porte la
date du mois de juin 1236.
Dans cet acte, le sieur de Brienne abandonna aux Templiers les cinq moulins
bannaux de Venizy, situés à Lames, et s'interdit le droit d'en
construire d'autres depuis Turny jusqu'à Avrolles, « a Turniaco usque ad
Evrolam. » Il leur concéda en outre le droit d'usage dans les bois de
Saint-Pierre, pour les réparations de leurs moulins, la faculté d'y prendre
chaque jour une charretée de bois, pour les besoins de leur maison de Turny, et
aussi le droit d'herbage, de pâturage et de passage dans toute la châtellenie
de Venizy, jusqu'à la limite de Burs. Les Templiers devaient, jouir du
droit de pêche dans leurs moulins, sans être tenus à aucune réparation des
ponts et chaussées, excepté à celle des planches du pont de Belaine
et de Borgeel. Quant à la chasse, elle était réservée au comte de
Brienne qui, toutefois, ne pouvait chasser dans l'enclos des Templiers; et
ceux-ci n'avaient le droit de chasser hors de leur enclos qu'en compagnie du
Grand-Prieur de France ou du commandeur de Coulours.
La maison de Turny, incendiée à la fin du XIVe siècle, fut reconstruite en
1460, par un frère de l'Hôpital, Jean du Buissel, alors curé de Turny, qui
avait pris à bail les terres de cette maison et le domaine du Luteau, dont il
sera parlé ci-après, moyennant un fermage de 16 livres tournois; et en outre
à la charge de rebâtir l'hôtel de Turny ainsi que la chapelle qui avait également
disparu.
En 1495, la maison fut détruite de nouveau, et depuis ne fut plus reconstruite.
Il en dépendait peu de terres, 60 à 70 journaux.
Au Commandeur appartenait le patronage et la collation de la cure de Turny, avec
la jouissance des grosses et menues dîmes. La terre et seigneurie de Turny
rapportait, en 1788, 1,950 livres. Il ne restait alors que trois des cinq
moulins de Venizy : le moulin d'en haut, le moulin d'en bas, et le moulin du
Luteau.
4)
Les multiples destructions de Turny
Au XVème siècle, Turny semble avoir été
complètement détruit si l'on en croit un rapport établi en 1460 par la commanderie du
Prieuré de France.
"Turny était jadis un groupement de maisons et plusieurs édifices, clos de
fossés... et qui, à l'occasion des guerres de ce Royaume était devenu ruine et
désolation ... Frère "Turny
était jadis un groupement de maisons et plusieurs
édifices, clos de
fossés... et qui, à l'occasion des guerres de ce Royaume
était devenu ruine et
désolation ... Frère JEAN BUSSEL, Curé de Turny, a
eu la charge de veiller à la reconstruction du village et
de la chapelle".
L'insécurité sur le territoire est
totale au XVIème siècle. Les Huguenots, authentiques pillards, organisaient des attaques
dans les villes et villages du royaume, répandant une véritable terreur.
C'est durant ce siècle qu'eut lieu la
construction de I’église et si son rôle était avant tout de sauver des âmes, il
consistait également à protéger des invasions des Huguenots.
En effet, l'alarme dans la seconde moitié
du XVIème siècle était donnée par un veilleur qui se tenait en haut du clocher. Une
cloche, "la cloche du guet" contenue dans une vaste lanterne octogonale
retentissait en cas d'alerte. Tous les habitants rentraient au village et on remontait les
ponts-levis des quatre portes.
Selon Bénony DURANTON, ..vers le milieu du XVIème siècle, les irruptions des ennemis
étaient très fréquentes. Le seul souvenir de ces guerres qui se soit perpétué se
situe au commencement du XVIIIème siècle. Le village tout entier fut détruit, ruiné et
devint la proie des flammes.
On
retrouve encore dans de vieilles maisons des poutres brûlées lors de cet incendie et qui
ont servi à la reconstruction du village...».
Sur le territoire se sont également
déroulées des batailles sanglantes.
Toujours selon Bénony
DURANTON,« … sous la Restauration ,au
moment où l'on plantait des vignes à Turny, les vignerons découvrirent un grand
nombre de vieux tombeaux en pierre. Les cimetières improvisés sont inséparables des
grandes batailles.
La côte
du Matroix et le Mont Champlain en fournirent d'assez nombreux échantillons avec quelques
débris de vases de fer et d'armes rongés par la rouille.
Ces
tombeaux qui n'étaient pas à une grande profondeur ne portaient paraît-il, aucune
inscription et ne contenaient que de rares débris d'ossements humains.
Un
vigneron, dans le début du XIXème siècle, a assuré avoir trouvé près de Linant les
restes encore reconnaissables d'un cavalier et de son cheval ... ».
découvrirent un grand
nombre de vieux tombeaux en pierre. Les cimetières improvisés sont inséparables des
grandes batailles.
La côte
du Matroix et le Mont Champlain en fournirent d'assez nombreux échantillons avec quelques
débris de vases de fer et d'armes rongés par la rouille.
Ces
tombeaux qui n'étaient pas à une grande profondeur ne portaient paraît-il, aucune
inscription et ne contenaient que de rares débris d'ossements humains.
Un
vigneron, dans le début du XIXème siècle, a assuré avoir trouvé près de Linant les
restes encore reconnaissables d'un cavalier et de son cheval ... ».
découvrirent un grand
nombre de vieux tombeaux en pierre. Les cimetières improvisés sont inséparables des
grandes batailles.
La côte
du Matroix et le Mont Champlain en fournirent d'assez nombreux échantillons avec quelques
débris de vases de fer et d'armes rongés par la rouille.
Ces
tombeaux qui n'étaient pas à une grande profondeur ne portaient paraît-il, aucune
inscription et ne contenaient que de rares débris d'ossements humains.
Un
vigneron, dans le début du XIXème siècle, a assuré avoir trouvé près de Linant les
restes encore reconnaissables d'un cavalier et de son cheval ... ».
5)
L'affaire des bois de Saint-Pierre (de 1226 à
1848)
Ce procès a duré plus de six siècles. Très complexe, en
voici un résumé. Toute l'histoire repose sur cette antique loi des bourguignons que
voici :
"Si quelqu'un n'a pas de forêt où couper
du bois pour ses divers usages, il a toute liberté d'en prendre où il lui plaira, pourvu
qu'il n'enlève que les arbres tombés par terre ou dépouillés de leurs fruits. Celui
qui appartient la forêt ne doit pas lui en empêcher".
C'est ce que l'on appelle le droit
d'usage. Cette possibilité de prendre tous les bois nécessaires au chauffage, à la
construction ou réparation de bâtiments, fabrication de meubles ou de tonneaux ne devait
pas s'étendre jusqu'à la vente d'objets fabriqués.
Il a été retrouvé un acte de 1168 sur
lequel SEVIN, Seigneur de Saint-Florentin, abandonne à l'Abbaye de Pontigny toute la
forêt de Saint-Pierre, où Venizy et Turny avaient leurs droits d'usage.
Dès le XIIIème siècle, la forêt de
Saint-Pierre qui fait partie de la Forêt d'Othe, et qui renferme environ huit mille
arpents excite la convoitise des habitants de Turny, Chailley, et Venizy.
En 1226 un différend éclata entre les
maisons des Templiers de Turny et Luteau, usagères de la forêt de Saint-Pierre et
l'abbaye de Pontigny, nouveau possesseur d'une partie de la forêt. Grâce à l'arbitrage
de médiateurs, des accords furent convenus.
Aux XIVème et XVème siècle, les
seigneurs et l'Abbaye de Pontigny copropriétaires se plaignent des graves dommages
causés dans la dite forêt, à leur détriment.
En 1247 et 1272, à l'aide de deux chartes,
Chailley et Venizy d'une part et Turny d’autre part, défendent leurs intérêts.
Ces chartes stipulaient que ERRARD DE
BRIENNE qui n'était pas encore Seigneur de Venizy et Marie MAHAUT son épouse avaient
abandonné la totalité de la forêt aux trois villages contre une redevance annuelle de
quatre deniers. Ces chartes ne sont pas reconnues comme étant authentiques, et leur
opposabilité n’est pas acceptée.
Pourtant, en 1548 tout semble s'arranger.
Venizy et Chailley obtiennent des droits d'usage sur deux mille huit cents arpents, et
TURNY sur deux mille cent soixante arpents, à titre provisoire, seulement. L’abbaye
et le seigneur en conservent chacun mille cinquante quatre arpents, exempts de tout droit
d'usage.
En 1640, les proches du seigneur de Venizy,
le Grand CONDE, élevèrent de vives protestations et déposèrent plainte pour les
nouveaux dommages causés aux bois.
Les officiers forestiers se plaignirent
d'avoir été molestés. Suivant les règles de droit alors en vigueur, les coupables de
ce délit se voyaient retirer le droit d'usage. Il y eut de nombreuses amendes. Turny fut
condamné à payer cinquante mille livres, somme considérable à cette époque et Venizy
trente deux mille livres. Le Prince, très clément, exerça son droit de grâce totale
sur cette affaire.
En 1642, le Prince consent une transaction
au terme de laquelle les habitants de Turny deviennent propriétaires de 1440 arpents sur
les 2160 utilisés à titre provisoire pour leur droit d'usage. Un bornage fut établi
après procès-verbal.
Quelques années plus tard, des
défrichements furent réalisés à une assez grande échelle. Le comte de CHEMERAULT qui
avait racheté la seigneurie de Venizy au Prince de CONDE voulut, en 1669, percevoir
"la directe" sur les terrains défrichés, c'est-à-dire les rentes que s'était
réservé le Prince sur l'exploitation de la forêt. Les habitants de Turny refusèrent et
en 1670 présentèrent une requête tendant à les affranchir de toute redevance.
Le comte de CHEMERAULT persista dans sa
démarche et le procès dura plus de six ans. De nombreux jugements contradictoires furent
rendus.
A cela s'ajoutait la revendication de
Chailley et Venizy de deux mille arpents à Turny.
Successivement, en 1789 puis en 1830, le
conflit réapparut et ne fut pas réglé. En 1848, la surface boisée avait diminué de
moitié en deux siècles et le problème devait trouver sa solution dans la disparition
partielle de ces bois.
Le 26 janvier 1893, Chailley
publie un livret intitulé "Les bois de Chailley" relatant toute
l'histoire de la forêt de Saint-Pierre et réclament à Venizy des parts de bois que
cette commune s’était injustement appropriée au fil des siècles.
La justice de la troisième République
donna raison à Chailley.
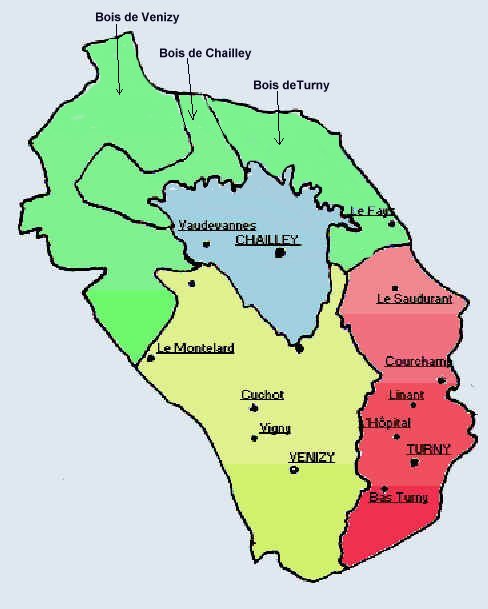
Cartes des communes de Venizy, Turny et Chailley avec les bois
annexés
B) LES PERIODES
PRE ET POST REVOLUTIONNAIRES
1)Turny avant la Révolution
1/1 Division
administrative du territoire avant la Révolution
Selon la carte des bailliages et
élections de VIVIER ( Carte des territoires des
anciens bailliages et élections dessinée en 1904 par VIVIER, sur les indications de
POREE, Archiviste. ), jusqu'en 1790, le territoire
de la commune de Turny appartenait à la province de Champagne et ne faisait pas encore
partie de la Bourgogne.
Sous l'ancien régime, la province est une
division territoriale placée sous l'autorité d'un délégué du pouvoir central.
L'ensemble de la commune actuelle
appartenait à la Généralité de Paris.
La Généralité était une circonscription
financière de la France à la tête de laquelle se trouvait un intendant.
A cette époque, l'unité territoriale de
la commune telle qu’elle apparaît aujourd'hui était loin d'être réalisée.
"La paroisse de Turny dépend de la
province de champagne du diocèse et du baillage de sens, du grenier à sel et de la
maréchaussée de st florentin.
Turny était sur la limite des
baillages de Sens au nord et Troyes au sud. Cette même limite partageait l'élection
de joigny- Montereau.
La justice est une prévoté seigneuriale
ressortissant au baillage seigneurial de Venizy et est régit en partie par la coutume de
sens, en partie par celle de Troyes "
Le bailliage était à cette époque une
division administrative délimitant les compétences territoriales en matière de justice.
Depuis la fin du XIIème siècle un agent
du roi, "le bailli", était chargé de faire fonctionner la justice dans le
bailliage dont il avait la responsabilité. Le Tribunal était présidé par ce bailli.
Bénony DURANTON (
( Annuaire de le Yonne - année 1854 : P.419 §IIII)
) nous explique quels étaient les problèmes de
compétences
territoriales juridictionnelles avant la révolution, suite
à des conflits intervenus à
la chapelle Saint-Laurent situé sur le chemin entre L'hopital et
Turny. Le chemin dont il s’agit ici est le C.D n°220 actuel
qui passe
par Le Bourget. A l’emplacement de cette chapelle est
aujourd’hui construite une
batterie d’élevage intensif de poulets destinés
à La Chaillotine
« ... A
l'occasion de la fête annuelle du 10 août qui donnait lieu à un pèlerinage à la
chapelle Saint Laurent , il arriva quelques années avant la révolution, une singulière
aventure. La foule des dévots pèlerins était nombreuse et, comme cela arrive souvent
dans les grandes assemblées, il s'éleva entre eux une rixe sur question de préséance.
Les esprits s’étant échauffés de part et d'autre, des menaces on passa aux coups
et la mêlée fut assez vive. Cette scène scandaleuse eut du retentissement. Les officiers
du seigneur de Turny se saisirent de l'affaire qu'avaient évoquée en même temps les
Officiers du Commandeur. Chacun d'eux exerçait la justice sur ces terres. Mais comme le
chemin était la seule limite qui séparât les deux juridictions, ils prétendaient que
la lutte avait eu lieu les uns en deçà, les autres au delà du chemin... »
Les deux bailliages qui se partagent le
territoire de la commune actuelle ont des Elections différentes. Ainsi Turny et les
hameaux appartenant au bailliage de Sens dépendaient de l'Election de Saint Florentin.
Les autres hameaux sont sous l'autorité de l'Election de Joigny et Montereau.
Enfin en matière de religion, la commune
dépendait du diocèse de Sens et de la paroisse de Turny.
Les Elections étaient des circonscriptions
financières sous l'ancien régime qui dépendaient des Généralités. Celles-ci
apparaissent en France en 1380, et ce mot « Election » sera plus
couramment utilisé dans la nomenclature administrative en 1452.
Au XVIème siècle, la monarchie
administrative adjoint, en se développant, aux élus des Elections et à leurs
lieutenants, de nombreux officiers.
Les lieutenants et les élus sont, au sein
des Elections, des administrateurs. En tant que tels, ils s’enquièrent des facultés
contributives de chaque paroisse. Ils répartissent ensuite entre les paroisses le montant
de la taille imputée à leur Election par les trésoriers du bureau des finances de leur
Généralité.
Pour les aides dont la perception est
affermée, leur travail consiste à préparer les adjudications.
Enfin en qualité de juge, les élus ont à
connaître des litiges mineurs nés de leur administration et à les trancher en dernier
ressort.
Les officiers comptables et les receveurs
particuliers ont pour rôle de centraliser les recettes de l'Election provenant des
collecteurs des tailles des paroisses et des fermiers des aides, puis versent ces sommes
au receveur général de la Généralité.
Selon Bénony DURANTON (Annuaire de l’ Yonne - année 1854 - P.393),
Turny, Linant et Courchamp , Turny, Linant et Courchamp avaient un
prévôt et une prévôté.
Un prévôt était un agent domanial placé
à la tête d'un domaine ou d'une circonscription du domaine - la prévôté - par
le roi ou un seigneur au Moyen Age, pour percevoir des revenus domaniaux, rendre la
justice. Il était investi en outre de pouvoirs administratif et militaires.
Enfin, le procureur fiscal qui résidait à
Turny était un officier chargé de veiller aux droits des seigneurs et aux objets
d'intérêts communs.
1/2
La vie
municipale en 1789
En 1789, la vie municipale est régie par
un règlement datant du 25 juin 1787 et instituant un conseil.
A Turny, ce conseil comprend trois membres
plus le seigneur et le curé, tous deux membres de droit. Les réunions ont lieu le
dimanche après la messe. S’il n'y a aucune question à traiter, on inscrit le
fait sur le procès verbal.
Les membres du conseil sont élus par les
paroissiens qui payent au minimum dix livres d'impôt.
Le syndic, qui n'est pas un magistrat comme
le deviendra le Maire plus tard, est cependant le personnage exécutif des décisions. Il
est le pivot de cet embryon de municipalité. C’est un agent de l'autorité
municipale qui tire son pouvoir de son élection annuelle, à la majorité simple.
Les débats à la veille de la
révolution... De quoi parle-t-on et que décide-t-on dans cette assemblée de village à
Turny ?
On vote les dépenses et on procède aux
nominations. On décide les ventes, les achats, les échanges, le locations de biens
communaux. On discute de la répartition des dépenses pour l'église, le presbytère, les
édifices communaux, les chemins, on fixe le ban des vendanges .
La démocratie à cette époque est aussi
directe. En effet, ce sont les habitants réunis en assemblée qui nomment leur maître
d'école, leur sergent (garde champêtre), les dîmeurs ( chargés de collecter
l’impôt ecclésiastique) et de tailles (impôts seigneuriaux).
Mais toutes ces délibérations de
l'assemblée, pour être valables, doivent revêtir une forme juridique. En l'absence de
juge, c'est le notaire qui est chargé de leur rédaction, ou parfois le maître d'école.
Après les délibérations, les votes ont
lieu à haute voix, sans aucune formalité. Si la discussion est vive, on procède
avec soin au décompte des voix.
2) Turny après la Révolution.
"Agrégat inconstitué de peuples
désunis",c'est ainsi que MIRABEAU caractérise l'organisation administrative de la France
de l'Ancien Régime qui, malgré l'action centralisatrice de la monarchie absolue, demeure
à la veille de la Révolution complètement disparate : les provinces ont des statuts
divers, les villes également. Quant aux communautés villageoises qui coïncident la
plupart du temps avec les paroisses rurales, elle ne connaissent pas de véritables
institutions municipales.
2/1
La naissance du Croissant : (Loi du 14 décembre.1789)
Le 12 novembre 1789 est une date
essentielle dans la
vie municipale qui est officiellement reconnue par l'assemblée constituante :
"Il
y aura une Municipalité dans chaque Ville, Bourg, Paroisse ou Communauté de Campagne".
C’est ce qui arrive à Turny dont les
limites paroissiales du territoire deviennent les limites communales
A la fin de l'année 1789 la
Constituante vote deux textes fondamentaux pour la vie locale.
D'une part, la loi du 14 décembre 1789 qui
établit le régime des municipalités.
D'autre part, celle du 22 décembre 1789
qui fixe le régime électoral et le régime administratif applicable aux communes.
Le 14 Décembre 1789 est donc une date historique pour la commune de
Turny qui naît de la tourmente révolutionnaire.
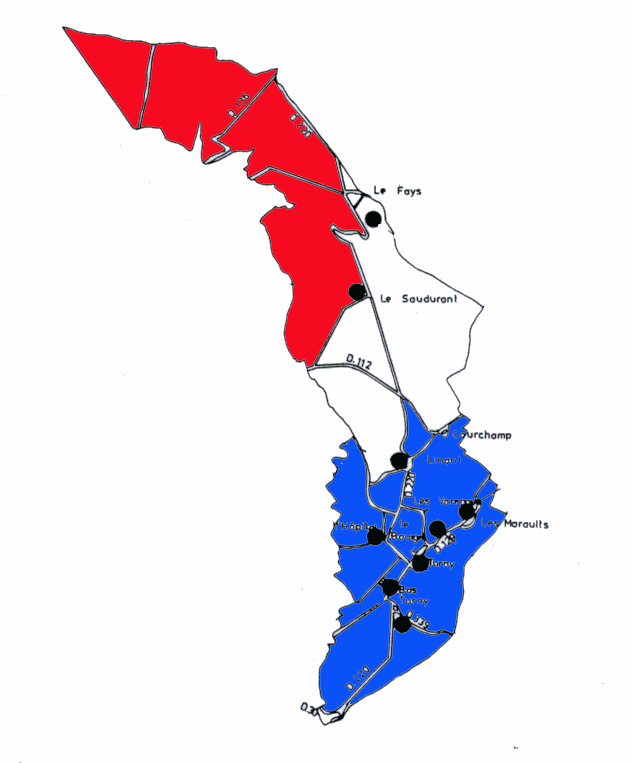
Les limites de la paroisse
deviennent les limites de la commune.
Cette loi qui prévoit la division
administrative en commune est une loi décentralisatrice. Elle est extrêmement importante
et novatrice parce qu'elle confère un statut nouveau à des territoires nouveaux.
Après sa naissance, la commune de Turny
sera gérée par "le Conseil Général de la Commune". Ancêtre du conseil
municipal, ce conseil général est composé d'un Maire, d’une assemblée de trois
membres formant le corps municipal et six notables (1), tous élus par les
habitants ou plus exactement par une fraction de la population. A cette époque en effet,
excepté sous le régime de la Convention, le suffrage était censitaire, c'est-à-dire
qu'il fallait être citoyen actif, payer le cens (2), n’être point en l'état
de domesticité et être français majeur de 25 ans pour pouvoir voter. Le cens
était une contribution directe d'une valeur de trois journées de travail. Cette
contribution sera inscrite dans la Constitution de 1791.
Pour les communes de moins de 4000
habitants, le Corps Municipal est de trois membres. Le nombre de notables est le double du
nombre de membres du Corps Municipal.
Enfin, il est important de préciser que la
commune, telle qu'elle a été créée et jusqu'à la loi du 2 mars 1982, ne possédait
pas la personnalité morale.
En d'autres termes, toutes les décisions
prises par le conseil municipal pour la commune étaient délibérées au nom de l'Etat.
La municipalité représentait l'Etat dans la commune. Ce statut juridique impliquait donc
un contrôle étroit du pouvoir central.
Au début de leur existence, les communes
disposaient malgré tout d'un certain nombre de pouvoirs. La loi établissait une
distinction fondamentale entre les compétences propres au pouvoir municipal et les
compétences d'administration générale de l'Etat qui sont déléguées aux
municipalités (Les fonctions directement
municipales et les fonctions d'administration générale déléguées par l'Etat après la
loi du 14 /12/1789 (voir quotidien du Maire N'520 - P.10)).
Mais la rigueur
centralisatrice du pouvoir
Jacobin, à partir de 1793, va s'accentuer et se perpétuer
jusqu'à en devenir une
tradition dans le mode administratif français de gestion. Pour
cela un Directoire
Départemental fut créé par la Constituante au
chef-lieu de chaque département. Il
représentait à côté du Conseil
Départemental, assemblée délibérante,
l'organe
exécutif permanent.
En janvier 1790, le nouveau découpage administratif
est adopté par les députés de l'assemblée nationale.
- Localement, le district de
Saint-Florentin comprend huit cantons dont celui de Venizy auquel appartenait la commune
de Turny avec Chailley, Champlost, Boeurs-en-Othe, et bien sûr Venizy.
Le Directoire du district, créé
également par la Constituante, fonctionnait au chef-lieu de chaque district, dans les
mêmes conditions que le Directoire Départemental à l'échelon supérieur.
2.2)
La fin de la Seigneurie et le développement de
l’anticléricalisme à Turny
A Turny, la Révolution va permettre aux
habitants de se libérer de l'emprise des seigneurs. Voici quelques témoignages
écrits :
Le 5 avril 1791 le conseil municipal de
Turny demande (Archives Départementale de
l'Yonne):
1) "L'autorisation de se pourvoir contre le ci-devant
Seigneur à l'effet de faire procéder à l'arpentage et au bornage des bois communaux et
de lui faire restituer avec rapport des fruits ce qu'il aura anticipé".
2) "A faire enlever du Choeur de l'église les bancs
du dit Seigneur qui les fera replacer dans tout autre endroit de l'église, dans les rangs
et dans la forme des autres".
3)"A faire sommation au ci-devant Seigneur de déposer entre les
mains d'un notaire tous les titres en vertu desquels il percevait différents droits en
argent et en grain pour que les habitants puissent en prendre communication".
Pour le premier point, Pour le premier point,
"le Directoire Départemental arrête qu'avant d'être autorisé
à se pourvoir en justice la Municipalité se rapportera à la consultation d'un homme de
loi..
En ce qui concerne le
deuxième
point, la délibération est homologuée par le
Directoire Départemental (Archives Départementale de
l'Yonne)
Enfin, afin de faire valoir la demande de
communication de titres, la municipalité est autorisée à intenter une action en justice
(Archives Départementale de l'Yonne).
Le 16 juin 1791, le Directoire
Départemental autorise la municipalité de Turny :
« à
former devant les tribunaux du District contre la veuve et les héritiers du Sieur de LA
ROCHEFOUCAULD, ci-devant Seigneur, une action en arpentage et bornage relativement aux
bois communaux de la communauté. »
La noblesse de Turny durant cette
période troublée est la cible privilégiée des habitants.
Le 22 mars 1792, François CHARBOIS,
huissier et notaire, plaide en justice la demande des habitants de Turny contre Anne
Sabine Rosalie de CHAUVELIN et feu Sieur de LA ROCHEFOUCAULD son mari, et contre Sieur
Polycarpe de LA ROCHEFOUCAULD, fils et héritier, pour la rentrée en possession de 720
arpents de bois et autres biens appartenant à la dite communauté.
En 1793, les communes de Turny, Venizy et
Chailley sollicitent une loi qui obligent les ci-devant seigneurs à servir aux communes
les revenus des biens qu'ils ont usurpé en attendant qu'ils soient contraints de les
restituer.
En France les événements se précipitent.
La première République est proclamée puis, sous la convention, LOUIS XVI est
guillotiné et la purge s'organise.
A Turny, en 1794 on apprend la condamnation
par let tribunal révolutionnaire de Anne Sabine Rosalie de CHAUVELIN et de sa fille
Alexandrine Rosalie de LA ROCHEFOUCAULD.
Le fils de Madame DE CHAUVELIN, Polycarpe
de LA ROCHEFOUCAULD, émigra et échappa à la guillotine (Notice sur Turny 1854).
Le 4 mai 1794, invitation de la Régie
Nationale est faite pour procéder à l'adjudication des biens séquestrés sur la veuve
de LA ROCHEFOUCAULD, sis à Turny.
Le 27 juin 1794, est effectué
l’examen des comptes du régisseur des biens séquestrés de la veuve de LA
ROCHEFOUCAULD, situés à Turny, Venizy et Neuvy. Les recettes pour l'année 1792-1793
sont de 62 947 livres, les dépenses de 41 956 livres (Archives Départementale de l'Yonne):.
La population de Turny va également entrer
en conflit avec le clergé. La Révolution a retiré de nombreux privilèges à
l’église et les curés acceptaient mal ces changements brutaux de leur mode de vie.
Les révolutionnaires, de leur coté,
réagissaient durement à l'égard du clergé.
Ainsi, le 10 avril 1792 :
"est
refusé une demande d'augmentation de traitement faite par le Sieur MALAQUIN, Curé de
Turny, fondée sur la nécessité qu’il est d'avoir un cheval, à cause de l'étendue
et de la population de sa Paroisse".
Le 7 février 1793 Le 7 février 1793
« est
refusée la demande du Curé de Turny afin d'obtenir un complément de jardin qui ne
contient pas le demi-arpent accordé aux Curés ».
Un rapport de 1798 montre que la pratique du culte était
contrôlée. Les noms des pratiquants sont soigneusement relevés ainsi que leur
comportement. Ce rapport mentionne :
« ... Edme Nicolas
MALAQUIN,
Curé de Turny 37 ans, Louis Joseph Boisseau, 30 ans, Curé de Turny...il n'y a eu de
fermentation que pour la vente des presbytères, mais l'administration centrale l'a
empêchée d'être dangereuse »
Le clergé local voit ses biens saisis et vendus comme biens
nationaux :
- le presbytère en 1798,
- la chapelle Sainte-Catherine à Linant, en 1796,
- les biens de la fabrique à Venizy,Turny, Lasson et autres biens
de la Commanderie de Coulours, situés à Turny le 14 août 1795 (Archives
Départementale de l'Yonne)
Les curés de Turny, face à cette attitude, semblent se rebeller
et dressent la population contre leur régime.
Un rapport de la police générale de 1793, atteste que la lutte
de l'église contre la Révolution s'organise à Turny et à Champlost.
Dénonciation par l'administration municipale du Canton de Venizy,
du ci-devant curé de Champlost de Joseph BOISSEAU, prêtre à Turny.
"...Le premier a tellement su
fanatiser le peuple crédule que, dès 1792, trois cents personnes se sont levées en
masse et ont assassiné trois citoyens qui avaient chanté un hymne à la liberté. Ses
partisans préparant, disent-ils, le peuple à faire de bonnes élections en germinal
prochain... » (Archives
Départementales de l'Yonne).
« ...A Champlost aucune fête
décadaire n'est observée, les croix se relèvent. On dit aux jeunes conscrits qu'on les
envoie à la boucherie et qu'il ne sont appelés que pour servir les factions. Il en est
de même à Turny où l'influence du Prêtre BOISSEAU est toute puissante... » .
A Turny, si l'emprise du
clergé semble incontestable en 1798, il
existe aussi des citoyens convaincus, tel que François CHARBOIS
notaire et huissier, qui
fit un essai de soixante huit articles sur le Code Judiciaire de la
République Française
en 1794 et qui le présenta à la Convention, la même
année ((Archives Départementales de l'Yonne).
Par ailleurs, les élus locaux clament les nombreuses
revendications de la population. Celles-ci ont été satisfaites en ce qui concernent les
biens de la famille de LA ROCHEFOUCAULD et du Clergé.
Les autres demandes ont été accueillies par le Directoire
Départemental avec plus de nuances.
Par exemple, le 16 février 1792Par exemple, le 16 février 1792
« la Commune demande une subvention de six cents livres
pour rendre praticable un chemin de Neuvy à Linant, lequel sert à l'exportation de ses
denrées sur Saint-Florentin et Brienon."
Rejet de cette demande :
"attendu que le Directoire ne
possède pas de fonds pour cet objet, la commune est invitée à se procurer les fonds
nécessaires par une imposition sur les propriétaires de son ressort"
(Archives Départementales de l'Yonne)
Devant le refus quasi systématique du Directoire Départemental
de prendre en charge le financement de bien communaux, le Conseil Général (ex
conseil municipal) de Turny fait des propositions afin de
pouvoir entretenir le territoire communal.
Le 22 octobre 1791, sur une délibération, le Conseil Général
demande
« l'autorisation de vendre 133 arpents de bois
communaux en réserve, de l'âge de vingt deux ans, et à en employer le prix, ainsi qu'il
suit :
400 livres à la réparation du puits
du hameau du Fey (Fays),
2400 livres à la plantation de 50
arpents de bois,
600 livres à la confection du pont du
hameau du Bas- Turny
400 livres aux travaux des rues,
200 livres à la réparation du toit du
presbytère,
200 livres à celle de la tour de
l'église,
300 livres à la confection de glacis
sur différents chemins
Le Directoire Départemental, avant de statuer, arrête :
« que
les requêtes et délibérations seront
adressées
aux officiers de la maîtrise des eaux et forêts de SENS,
pour avis" (que les requêtes et délibérations
seront adressées
aux officiers de la maîtrise des eaux et forêts de SENS, pour avis" (Archives Départementales de l'Yonne).
__________________________________
Ladmiral (Lamiral), Pierre (franç.) P.
Lamiral (LEP IV, 123); Amiral (SOCP).
N. 15 déc. 1723, en Champagne, Turny (Yonne).
E. 30 juin 1744, Nancy (Camp. 20, 417) ou 30 juillet (Camp. 16,
176).
Emb. à Lorient sur le Duc de Duras, 18 janv. 1766 avec les PP. BARON et
de VENTAVON (AN: Col. F5B 49); arr. 1766; tente d'entrer en Chine et fait
prisonnier, puis passe au Hukwang et en 1778 au Hunan.
P. Reims, 12 juin 1756,par l'évêque "Cydionensi" (=de Canea, en Crète),suffragant
de l'archevêque de Reims (Camp. 17, 126).
V. Enisheim (cf DELATTRE, II 370-385), 15 août 1759, pr. (Gal. 24, 402).
M. déc. 1784 au Hukwang, "quelques jours avant que le mandarin
vienne" (persécution de 1784) (B. Inst. 1520 fo 263).
Est appelé Fr. Xavier LAMIRAL (AN: Col. F5A 24). Ne pas le confondre avec le
P. Pierre L'ADMIRAL, N. diocèse de Nevers 20 nov. 1741, E. 11 oct. 1756, Paris,
et M. à Douzy, Ardennes, juin 1823.
"Fils de Toussaint LADMIRAL (profession non indiquée) et de défunte
MARTIN, né et baptisé le 15 déc. 1723" (renseignements aimablement
communiqués par Mr P. MASTRACCI, des Archives Départementales de l'Yonne).
Pf. 912.
Source: Dehergne, Répertoire (1973)
C)
LE XIXème SIECLE
Ce siècle est celui de Bénoni
DURANTON qui a consacré beaucoup de
son temps à retracer l'histoire de Turny.
Nous pouvons néanmoins regretter qu'il n'ait pas laissé davantage de
témoignages personnalisés sur la vie des habitants de Turny, ou sur les grandes
décisions municipales qui ont pesé sur la vie des citoyens ou encore modifié
substantiellement l'aspect du village.
La lecture du registre des délibérations municipales concernant cette
époque ainsi que des recherches aux Archives Départementales de l'Yonne et divers
écrits... vont permettre en partie de pallier à cet inconvénient.
a)
Les fossés de
l'enceinte fortifiée
C'est au XIXème siècle que Turny prend peu à peu l'aspect actuel. En
1827, le village avait encore 253 toits de chaumes pour268 de tuiles (Annuaire de le Yonne - année 1854).
Les ponts de grès ont remplacé les ponts-levis. La dernière
porte fut détruite au milieu du XIXème siècle.
Les fossés qui existent encore actuellement autour du village ont vu
leur largeur considérablement réduite, permettant ainsi de tracer un chemin ceinturant
le bourg et qui a été asphalté pour la première fois vers la fin des années 1980.
Malheureusement, l'écoulement des
eaux deviendra difficile. Par
ailleurs, en l'absence de réseau d'assainissement, ces
fossés seront utilisés par les
habitants pour l'évacuation des eaux usées. Jusqu'au
milieu du XXème siècle, cette situation va perdurer.
Ensuite, des mesures d'hygiène (fosses septiques) associées à
l'évolution des mentalités vont permettre de stopper cette pollution liquide de
l'environnement.
D’autre part, dans les années 1970, des travaux seront réalisés
près du lavoir au Nord-Ouest du village, en vue de détourner une partie du ruisseau de
Linant dans ces fossés, permettant ainsi de renouveler une eau stagnante.
Malgré cela, le courant reste insuffisant, de la boue provenant en
grande partie de l'effondrement des berges comble sans cesse le lit de ces fossés. Aussi,
des nettoyages réguliers décidés par la municipalité doivent-ils être effectués.
De plus en plus souvent, les riverains prennent en charge l'entretien
du fossé qui jouxte leur propriété. Certains même l'aménagent :
- en réduisant la largeur,
- en disposant des grillages pour leur poissons d'agrément,
- en comblant définitivement le fossé, après avoir installé des
buses d'écoulement de diamètre conséquent. Dans ce dernier cas, le riverain s'est
auparavant rendu propriétaire des lieux. Dans ces eaux troubles envahies par une
végétation aquatique abondante et recouverte, durant la belle saison, par des lentilles
d'eau aux verts fluorescents, une faune de têtards, d'épinoches, de carpes, et de
poissons rouges cohabitent.
b) Turny choisit son destin
Ce siècle est pour Turny l'amorce du déclin.
Le projet de voie ferrée Strasbourg-Lyon, avec une gare locale, ne se
concrétisera pas.
Aucun objectif de développement du tissu industriel ou artisanal
conséquent,
Turny oriente son choix uniquement vers l'agriculture
Les conséquences ne tardent pas à se faire sentir. La
désertification rurale prend le pas. En un siècle, la population de la commune
diminue de moitié, passant de 1500 à 794 habitants .
A cette époque, les habitants vivent en autarcie au rythme des
saisons. De petits commerces et artisanats locaux se sont développés et prospèrent
grâce à une clientèle d'agriculteurs et d’ouvriers agricoles vivant sur une petite
exploitation familiale dépassant rarement vingt hectares et sur laquelle toute une
famille et parfois même trois générations cohabitent.
A Turny, 80% de la population vit d'occupations agricoles au milieu du
XIXème siècle. Malgré la diminution sensible de la population qui va s'accentuer au
début du XXème siècle, la commune reste jusqu'à la fin du XIXème siècle le foyer
d'une activité intense
c) La disette de 1817
A cette époque, la population se nourrit essentiellement de la
production agricole locale et les mauvaises années entraînent des disettes telles
qu’en juin 1817.
Dans un rapport
adressé au Préfet
, le Maire de
Saint-Florentin explique comment se déroule ce début de
famine dans la région ( Archives Départementales de
l'Yonne)
" ... Plus de 200 brigands, car on ne peut les appeler autrement,
ayant tous un sac sous le bras... les uns pour avoir du blé à la taxe de cinq francs le
boisseau( Un boisseau : environ 12,5
litres ), les autres
pour l'avoir au même prix et à crédit, les autres enfin pour l'avoir pour rien.
Cependant, je ne puis vous
dissimuler que certains sont dans un pressant besoin et ce besoin exigerait que ces
malheureux puissent se procurer du blé en en exposant au marché du gouvernement, ce qui
aurait le double effet de satisfaire les besoins les plus pressants et de l'autre
d'engager ceux des cultivateurs, qui ont encore quelques grains, à
les mettre en vente et à en baisser le prix... »
Turny, Neuvy, Lasson
Venizy Chailley furent ce mois-là pillés. Le
Préfet enverra dans les jours suivants soixante bichets de
blé( Un bichet : Ancienne mesure de capacité pour le
grain
variant de 20 à 40 L)( Un bichet : Ancienne mesure de
capacité pour le grain
variant de 20 à 40 L)).
d)
Quelques
faits divers de ce siècle
1) BONNEMAIN Louis Polycarpe, instituteur à Turny, ex-prêtre de
l'ancien diocèse de Troyes, curé de Vanlay qui s'était marié en 1793 pour échapper à
la mort, obtient du Pape un rescrit de validation de son mariage le 20 septembre
1802. Un rescrit : Réponse du Pape à
une supplique ou à une consultation. Dans le cas présent le mariage, malgré les
circonstances, est validé.
2) En décembre 1813, la commune de Turny demande au doyen de Brienon,
FROMENTOT, l'autorisation "d'établir" deux soeurs de la Providence, appartenant
à la maison de Me BRESSON de Ligny.
3) Une requête datant de 1822,
adressée au Préfet, dont l'original a amicalement été mis à ma disposition par René
CORGERON en 1979, relate les problèmes internes d'un conseil municipal en désaccord.
Au-delà
du conflit au sein du conseil municipal et des pratiques auxquelles le Maire semble se
prêter, cette requête est riche d'enseignement dans la mesure où elle révèle des
indices précieux sur l'aménagement local de quelques lieux.
Le chemin, situé à proximité de l'habitation de DURANTON dont il est
question dans ce courrier, serait celui qui joint Turny à L'hopital en passant, près du
lavoir, par les prés St-Laurent. Ce chemin a d'ailleurs été appelé par la
municipalité en 1986 rue de la croix st Pierre.
Selon René CORGERON, la route départementale n°220 n’existait
pas à cette époque et la seule voie d'accès reliant les hameaux était ce chemin dont
un carrefour, situé près du lavoir de L'hopital, permettait d'ailleurs de rejoindre soit
L'hopital ou soit directement Linant.
Nous apprenons également que le pont situé sur les fossés de la
rue de la crois St-Pierre, près du lavoir, a été construit dans les années
1820. Ce pont, qualifié par l’opposition municipale de très
« dispendieux », a fait l’objet d’une protestation auprès du
Préfet , le marquis de Garville (voir courrier
fin paragraphe).
Par ailleurs, le n°3 de la rue de la croix St-Pierre
était la demeure natale de Bénony DURANTON dont le père, Louis Laurent Isodore (maire en 1808), était receveur municipal et conseiller municipal en 1822
(confirmation par acte décès de Louis Laurent Isodore Duranton).
Enfin, d'autres sources précisent
que la famille SALLOT DE MONTACHER était propriétaire du château des Varennes et de la
ferme située en face ce château. Cette requête, nous informe que le chemin d'accès à
cette ferme qui permet également de joindre le cimetière aujourd'hui, a été réalisé
au début des années 1820.
4) L'école
Juin 1838
"L'école du Sieur Testa est mal tenue , de l'aveu même du
Sieur Testa qui n'a pas craint de dire qu'il regarde l'état d'instituteur comme une état
de paresseux »"L'école du Sieur Testa est mal tenue , de l'aveu même du
Sieur Testa qui n'a pas craint de dire qu'il regarde l'état d'instituteur comme une état
de paresseux ».
5)Le XIXème siècle, c'est aussi la
guerre de 1870 responsable de la mort de cinq soldats.
6) Le Moulin Neuf : Il n'a pas été retrouvé de texte sur la
date de construction de ce moulin, mais un bail du 12 août 1822, dont
copie m'a été aimablement adressée par Monsieur BESANCON du Bourget, précise que ce
moulin était loué depuis le début du siècle à M.PAILLERY, par Madame de LA
ROCHEFOUCAULD, propriétaire. La famille PAILLERY en fit
l’acquisition avec les dépendances en 1855 et en est propriétaire depuis près
de 140 ans aujourd'hui .
7) Les premiers plans de la commune postérieurs à la révolution sont
dressés en 1811 par Monsieur CHARLES, géomètre
5) Découverte macabre (mars
1814) (Archives départementales de
l'Yonne, 5 MI 960)
"Ce jourd'hui
vingt cinq mars mil huit cent quatorze heure de midy, nous Edme André JOSSOT,
membre du conseil municipal de la commune de Turny faisant les fonctions
d'officier de police de l'Etat civil à cause de l'absence et de l'empêchement
de messieurs le maire et les adjoints de laditte commune, ayant été instruit
par différentes personnes que le nommé Victor Frottier, berger commun du
hameau de l'Hopital commune dudit Turny avait aperçu dans le rouloir de Laurent
Cassemiche situé au dessous dudit hameau de l'Hopital à une distance d'environ
trois cents pas, un objet qui ressemblait à une tête de chrétien ; à
l'instant, nous nous sommes transportés sur ledit lieu où étant, nous y avons
trouvé plusieurs personnes qui examinaient cet objet. Nous avons spécialement
remarqué dans ces personnes Pierre Cassemiche, couvreur, François Raton,
maçon, Jean-Pierre Barbat, Nicolas Barbat, Pierre Lamblin, meunier à Venizy,
Edme Lamblin, François Moreau, cordonnier et tous domiciliés excepté ledit
Pierre Lamblin dans la commune dudit Turny. Nous avons à l'instant, en leur
présence et à l'aide desdits Cassemiche et Raton, tiré hors dudit rouloir,
qui contient environ trente pieds en quarré et huit pieds d'hauteur plein
d'eau, ledit objet et ensuite nous avons reconnu que c'était le corps du nommé
Jean Tissu, en son vivant couvreur, demeurant audit lieu de l'Hopital, âgé de
quarante cinq ans, marié à Suzanne Bedeau, âgée de trente huit ans indigant
et après l'avoir examiné nous ne lui avons aperçu aucune contusion, ledit
Tissu étant évadé de sa maison dès le douze février dernier à ce que
disent sa femme et son voisin à cause de la grande frayeur que lui avaient fait
les ennemis étrangers qui séjournaient chez lui et comme il y a tout lieu de
craindre la mauvaise exalaison à cause de la corruption, nous ordonnons que le
cadavre sera enterré dans le cymetière de Turny dans le plus bref délai
possible."
Pour info : Décès de la commune de Turny pour 1812 = 29 ;
pour 1813 = 33 ; pour 1814 = 71 ; pour 1815 = 32 ; pour 1816 = 25....(Archives
départementales de l'Yonne, 5 MI 960)
6) XXème et
XXIème siècle (faits divers)
1)
22/7/01
3000 litres de fioul se déversent
dans un fossé : sabotage à la scierie de Turny
Un tuyau d’alimentation du
groupe électrogène a été entaillé. Le risque de pollution est écarté.
« En
arrivant à la scierie vers 8h30, mon frère s’est aperçu qu’il y avait du
fioul partout. Il a tout de suite remarqué que le tuyau de départ du fioul,
entre la citerne et le groupe électrogène, avait été sectionné ».
Abasourdi mais pas résigné, Dominique Hennon raconte la nouvelle mésaventure
dont vient d’être victime la scierie qu’il dirige avec ses deux frères, au
Bas-Turny, entre Brienon et Saint-Florentin.
Samedi matin, la citerne servant à alimenter le groupe électrogène était
vide. Les 3000 litres de fioul qu’elle contenait, livrés deux jours plus tôt,
s’étaient écoulés sur le site et répandus jusque dans un fossé longeant
la rue de la Brumance. Immédiatement, les gérants ont répandu de la sciure
pour tenter d’absorber les flaques de fioul. Mais le mal était fait. Où plutôt
l’acte de malveillance puisque le tuyau d’alimentation du groupe électrogène
a été entaillé. Dominique Hennon a donc déposé une plainte auprès de la
gendarmerie de Brienon.
Le lendemain matin, dimanche, un habitant du Bas-Turny se plaignant de fortes
odeurs de fioul a, à son tour, alerté les autorités. Les gendarmes se sont
rendus sur place, accompagnés de pompiers de Joigny, placés sous le
commandement du Lieutenant Ramos. Les pompiers ont installé un petit barrage
avec des ballots de paille pour éviter que le fioul n’atteigne un cours
d’eau. « Il n’y a pas de risque de pollution majeure », assurait
t-on hier au centre de secours de Joigny.
Il restait encore à évacuer le fioul du fossé. L’opération, à la charge
de la commune, devait être réalisée hier après-midi par une société
d’assainissement de la région.
« Les outils de productions sont visés »
A la scierie de la famille Hennon, la fuite de fioul est synonyme de perte sèche
(environ 6000 F hors taxes) mais aussi de chômage technique momentané. Il faut
en effet attendre une nouvelle livraison de fioul pour remettre en route le
groupe électrogène qui fournit l’électricité pour faire fonctionner les
machines.
Le plus inquiétant est que cet acte de malveillance n’est pas le premier.
« Depuis trois semaines, la cadence s’accélère », s’inquiète
Dominique Hennon. « Ce sont les outils de production qui sont visés, pour
bloquer l’activité de la scierie. Depuis qu’on est sur le site du Bas-Turny,
on n’avait jamais eu autant de problèmes ».
Ainsi, dans la nuit du 12 au 13 juillet, une armoire électrique a été dégradée
et des bidons d’huile ouverts. Une semaine plus tôt, du petit matériel a été
volé, puis retrouvé dans le voisinage au cours d’une perquisition menée par
les gendarmes.
Dans le village, personne n’ignore les relations tendues entre la
scierie et
son voisinage. Des problèmes qui ont poussé un peu plus
la famille Hennon à délocaliser
la société. « La scierie
déménage à Saint-Florentin, où
l’activité
commencera au début du mois de septembre. Nous quittons le site
du Bas-Turny
pour deux raisons, parce que le terrain ne nous appartient pas et
à cause du
voisinage ».
RECTIFICATIF
Suite à notre article d’hier sur la sabotage de la scierie
de Turny, nous précisons que le maire a pris des mesures conservatoires.
Les responsabilités restant à déterminer, les assurances interviendront en
fonction des conclusions des experts.
La commune n’a été et ne sera en aucun cas sollicitée financièrement
23.02.02 Un adolescent tire sur son père
à Turny
Un habitant de Turny (canton de Brienon-sur-Armançon) a été sérieusement
blessé par son propre fils, jeudi dernier, vers minuit. De source officieuse,
l’adolescent, âgé d’une douzaine d’années, aurait tiré sur son père
à l’aide d’un fusil de chasse.
Blessée sous le thorax, la victime a été découverte inconsciente par les
pompiers de Saint-Florentin, qui l’ont transporté au centre hospitalier
d’Auxerre. Toutefois, son état de santé, hier, ne laissait pas craindre
d’issue fatale.
Le jeune auteur du coup de feu a d’abord été recueilli par les gendarmes de
Brienon-sur-Armançon, avant d’être confié au tribunal pour enfants
d’Auxerre. On ignore pour l’instant les causes de ce drame familial.
01.09.03 Turny fête le
cidre du pays d’Othe
 Les organisateurs, membres du Comité de développement du pays d’Othe, se
disaient ravis du déroulement de la quatorzième édition de la Fête du cidre,
hier, à Turny. Un peu plus de 1 000 entrées ont été comptabilisées
en milieu d’après-midi, et cette ambiance conviviale propre à la fête
tournante a été unanimement louée.
Les organisateurs, membres du Comité de développement du pays d’Othe, se
disaient ravis du déroulement de la quatorzième édition de la Fête du cidre,
hier, à Turny. Un peu plus de 1 000 entrées ont été comptabilisées
en milieu d’après-midi, et cette ambiance conviviale propre à la fête
tournante a été unanimement louée.
« C’est un honneur pour notre commune de célébrer le cidre du pays
d’Othe », a souligné Marie-Christine Hennon, maire de Turny, lors de
son discours.
Louisette Frottier, présidente du Comité de développement du pays d’Othe,
qui rayonne sur douze communes et cinq cantons, a, elle, tenu à rappeler que
« son » pays produisait pas moins de 20 000 bouteilles de
cidre chaque année. L’été, les touristes le goûtent. « Il fait bon
dans nos caves, cette boisson désaltère », notait la présidente. Puis,
tout au long de l’année, les habitués l’apprécient. Sur les stands du
terrain des Maraults, forcément, il a coulé à flots.
Les animations, aussi, ont trouvé leur public. Dès 9 heures, par exemple,
une bonne cinquantaine de marcheurs participaient à la traditionnelle randonnée
en pays d’Othe. Pays que le comité de développement s’attache, depuis
plusieurs années, à promouvoir par tous les moyens. Belle récompense, pour
ses membres, que ce succès populaire d’hier.
2)Joëlle
Aubron ancienne membre d'Action Directe en sursis à Turny/Linant
(extrait
l’Yonne Républicaine du 16 juin 2004)
L'ancienne activiste du groupe Action Directe (AD) Joëlle Aubron est sortie
vers 9h30 du centre de détention de Bapaume, dans le Pas-de-Calais, mercredi 16
juin 2004 au matin.
Après sa libération, elle a pris la direction de l'Yonne. Elle est arrivée
dans la soirée à Turny dans le hameau de Linant où
résident ses parents.
Elle va séjourner dans sa famille et essayer de suivre un traitement pour
soigner une tumeur cancéreuse au cerveau, dont elle a été opérée à Lille
au mois de mars.
Joëlle Aubron, 45 ans, avait été condamnée, en 1989, à la réclusion
criminelle à perpétuité pour sa participation aux assassinats du PDG de
Renault, Georges Besse, et de l'ingénieur de l'armement René Audran.
Affaiblie, visiblement fatiguée, cachant une calvitie causée par son
traitement médical, elle a été accueillie à sa sortie de prison par une
vingtaine de membres du comité de soutien aux prisonniers d'AD, qui ont chanté
"l'Internationale".
Les premiers mots de Joëlle Aubron ont été pour ses anciens camarades
d'Action Directe toujours incarcérés.
"Leur libération est une bataille qui va continuer", a-t-elle déclaré.
Elle a regretté "que la loi Kouchner qui permet aux prisonniers malades de
sortir de prison" ne soit "pas appliquée de la même manière pour
tous".

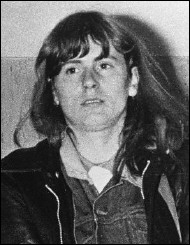


Joëlle
Aubron à sa sortie de
prison
J. Aubron en
1987
J.Aubron 2006
Le 21 février 1987, Joëlle Aubron avait
été arrêtée dans une ferme à Vitry-aux-Loges, ainsi que les trois autres
leaders historiques d'AD. D'abord incarcérée à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis
(Essonne), elle sera transférée, ainsi que Nathalie Ménigon, au centre de détention
de Bapaume en octobre 1999.
Trois autres anciens membres d'AD sont encore incarcérés
Nathalie Menigon, 47 ans est elle aussi détenue à Bapaume. Elle a été
victime de deux accidents vasculaires cérébraux et souffre d'hémiplégie.
Jean-Marc Rouillan, 51 ans, souffrirait d'un cancer du poumon et Georges
Cipriani a sombré dans la folie pendant son incarcération.
La juridiction régionale de libération conditionnelle de la cour d'appel de
Douai (Nord) avait décidé lundi de lui accorder une suspension de peine pour
raison médicale. Elle reste sous le contrôle d'un juge d'application des
peines.


L'yonne
Républicaine du 17 juin 2004
DIJON,
21 sept 2004 (AFP)
Joëlle Aubron (AD) interdite
de sortie de l'Yonne
La justice a interdit
mardi à Joëlle
Aubron, militante du groupe Action Directe (AD) -libérée
de prison en juin
pour raison de santé- de sortir du département de l'Yonne
où elle vit, sauf
pour des traitements médicaux, a-t-elle indiqué à
l'AFP. Cette décision a été
prise par un juge d'application des peines du tribunal de Sens (Yonne),
a
expliqué Joëlle Aubron, confirmant par
téléphone l'information révélée
par France 3 dans son journal du soir. Joëlle Aubron, 45 ans, est
sortie le 16
juin du centre de détention de Bapaume (Pas-de-Calais)
après avoir été opérée
en mars d'une tumeur au cerveau au CHRU de Lille. Elle vit actuellement
chez ses
parents à Turny (Yonne) entre Auxerre et Troyes. La juridiction
régionale de
libération conditionnelle de Douai (Nord) lui a accordé
une suspension de
peine sous surveillance du juge d'application des peines de Sens.
Joëlle Aubron
a précisé qu'elle pourrait sortir de l'Yonne uniquement
pour se rendre à
Lille et à Paris, où elle suit un traitement
médical, ainsi qu'à Grenoble où
réside son avocat. Elle a qualifié de "sanction" la
décision prise,
selon elle à la demande du parquet, par le juge d'application
des peines.
"Je trouve cela absurde. Je n'ai rien fait qui pourrait laisser
entendre
que je mérite une telle sanction", a-t-elle
déclaré. "Il n'y a
aucune raison à cette mesure, sinon que l'on veut m'interdire de
voir les gens
avec qui j'ai des liens", a-t-elle souligné. L'ancienne
militante d'Action
Directe a indiqué qu'elle attendait de voir les attendus de la
décision de
justice pour décider ou non de faire appel. Joëlle Aubron a
été condamnée
en 1989 et 1994 à la réclusion à
perpétuité, assortie d'une période de
sûreté
de 18 ans, comme les trois autres membres du noyau dur du groupe
terroriste,
notamment pour les assassinats du PDG de Renault Georges Besse et de
l'ingénieur
général René Audran.
Joëlle Aubron, 46 ans, dont 17 passés
en prison, est décédée à mercredi 1er mars 2006 dans l'après-midi à Paris.
Atteinte d'un cancer du poumon, dans le coma depuis plusieurs jours, elle était
la seule des quatre membres historiques du groupe en liberté. C'est justement
pour raison de santé qu'elle avait bénéficié d'une suspension de peine en
juin 2004 après avoir été opérée d'une tumeur au cerveau. Son cancer
principal, aux poumons, avait été détecté un an après sa libération.
Vendredi dernier, sa famille avait été appelée à son chevet dans l'unité de
soins palliatifs où elle était soignée.
__________________________________________________________________
Tribunal
correctionnel de Sens
AFP 23.09.04 à 20h35
Prison ferme pour avoir
poignardé sa femme à Turny
Un habitant de Turny, Patrick MAIGNE, âgé de 44 ans a été condamné hier
à trois ans de prison dont 18 mois assortis du sursis avec mise à l’épreuve
de trois ans pour avoir porté des coups de couteau à sa femme. Placé sous
mandat de dépôt le 7 octobre 2003, il sera maintenu en détention.
Le jugement prononcé par le tribunal correctionnel de Sens présidé par
Chantal Charruau, correspond aux réquisitions du substitut du procureur de la République
Thomas BRIDE.
Les faits se sont produits il y a un an, le 5 octobre 2003.
29.10.04
: un sac oublié dans la voiture d'une habitante de Turny
Sœur Mathilde Graff est bien connue à Maligny. Dimanche après-midi, elle
revenait de Paris en compagnie d’une amie religieuse à Saint-Florentin, par
le train de 17 h 32. Elles sont descendues à Vergigny et une dame de Turny, qui
était venue chercher un voyageur, s’est gentiment proposée pour les conduire
jusqu’au presbytère de St-Florentin où était garée l’auto de la
religieuse.
Hélas, dans sa précipitation à l’arrivée au presbytère, Sœur Mathilde a
oublié son sac de voyage coincé entre deux sièges dans la voiture de la dame.
Depuis, elle n’a pas eu de nouvelle de ce sac car, explique-t-elle : « Il est
coincé à l’arrière de l’auto et il y a fort à parier que personne ne
l’a vu ».
Pas question, bien sûr de mettre en doute la probité de la charmante
conductrice, mais ne connaissant ni son nom, ni son adresse, Sœur Mathilde ne
sait à quel saint se vouer pour retrouver son bien. Alors elle lance cet appel.
Il n’y aura pas de prime mais de chaleureux remerciements.
• Sœur Mathilde Graff, 19, rue Chardonnay à Maligny
Voeux du maire Stéphane GALLOIS en janvier 2011

Stéphane Gallois a présenté ses voeux aux habitants de Turny.
Samedi après midi, de nombreux habitants de Turny se sont déplacés à la
salle des fêtes pour assister à la traditionnelle cérémonie de présentation
des voeux du maire, Stéphane Gallois, et des élus du conseil municipal.
À cette occasion, le maire a remercié son équipe ainsi que les employés
communaux pour le travail accompli en 2010. Il a également félicité les
associations pour leur dynamisme et a déclaré : « A Turny, il y
en a pour tous les âges, de Ensemble pour les enfants de Turny au club des aînés.
Il y en a aussi pour tous les goûts, de la moto à la broderie. »
Pas d'augmentation des impôts communaux
L'élu a aussi souhaité la bienvenue à une nouvelle association A tous
points fraîchement installée dans la commune. Puis, Stéphane Gallois a
évoqué quelque temps forts de cette vie associative avec, notamment, le succès
de la marche nocturne gourmande particulièrement bien organisée.
Il a ensuite évoqué les perspectives pour cette année 2011. « Nous
vivons des temps incertains », a-t-il déploré. « Il est
difficile d'obtenir des subventions et celles-ci se révèlent, la plupart du
temps, trop faibles. » Stéphane Gallois a cependant rassuré ses
administrés en promettant qu'il n'y aurait pas d'augmentation des impôts
communaux.
Il a passé en revue les différents travaux qui seront réalisés :
bordures et assainissement à Linant et au Fays, renouvellement des panneaux
routiers, aires de jeux, parking du cimetière, transformateur électrique du
Fays. Il a présenté les grands dossiers qui devraient avancer, tels que
l'assainissement à Turny et dans les hameaux ou encore, un projet
d'installation d'éoliennes.
Pour terminer, Stéphane Gallois a évoqué l'adhésion à la communauté
de communes du Florentinois ainsi que les domaines qui s'y rattachent :
école de musique, ramassage des ordures ménagères et déchetterie, complexe
tennistique et projet de pôle d'excellence rurale (PER) autour de l'aérodrome
de Chéu.
Après la remise de prix aux différents concours, le maire a conclu :
« Pour 2011, je vous souhaite à tous, plus d'espoir avec toujours plus
de joie et d'humanité. »
Patrick Tapin
JANVIER
2011 : Le maire a réuni les grands acteurs de la vie communale.
Samedi
soir, le maire de Turny avait réuni, pour un apéritif suivi d'un repas, ceux
qu'il a qualifiés de « grands acteurs de la vie communale ».
Étaient
présents des membres du personnel communal, du conseil municipal, des
associations et du Centre Communal d'Action Sociale (CCAS).
« Il se passe toujours quelque chose dans notre village »

C'est
la deuxième fois que Stéphane Gallois organisait une telle réunion.
« Le but de ce repas annuel, explique-t-il, est de permettre aux gens de
se connaître mieux pour mieux travailler ensemble, car les interactions entre
les différents partenaires sont nombreuses. »
Le
maire a tout d'abord salué les nouveaux présidents des associations et
souhaité la bienvenue à l'association A tous points, nouvellement installée
dans la commune. Il a demandé à chacun de garder son dynamisme.
24
manifestations en 2010
« Nous
sommes à mi-mandat et, chacun à notre place, nous devons rester motivés.
Nous avons une équipe qui fonctionne et notre commune est dynamique. Il se
passe toujours quelque chose dans notre village. Ce ne sont pas moins de 24
manifestations qui ont eu lieu dans la commune durant 2010, et 56 articles de
l'Yonne Républicaine ont rendu compte des
activités de Turny. »
En
conclusion, le maire a souhaité que l'année 2011 soit encore plus riche en
événements que 2010 et il a invité les 64 participants à partager le pot
de l'amitié et le dîner
Patrick Tapin
Associations
représentées
.
Amicale des sapeurs-pompiers, les Amis du patrimoine, l'association sportive
de Turny, A tous points, la compagnie du parapluie, Ensemble pour les écoles
de Turny, moto club de Turny, Notes en Othe, Turny Danse, Turny sports
loisirs.
TURNY
samedi 29 janvier 2011
Un radar pédagogique à l'entrée de Turny

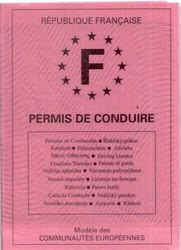
Ils contrôlent la vitesse, ne la sanctionnent
pas, mais alertent sur l'excès que peut effectuer l'automobiliste dans un
des hameaux de Turny. Les radars pédagogiques installés fonctionnent.
Chiffres à l'appui.
Pour apprendre et prendre conscience, deux écoles : la méthode
douce, et celle plus dure qui passe par la sanction. Dans le domaine de la
vitesse en voiture, Turny a préféré aborder le problème de sécurité
routière sous l’angle pédagogique.
Depuis quelques mois, un radar pédagogique tourne sur les hameaux de la
commune. Comme son nom l’indique, ici, il ne s’agit pas de punir mais de
prévenir.
« Comme dans toutes les communes traversées par des routes, la
sensation d’excès de vitesse est là. Et elle n’était pas mesurée »,
signale Stéphane Gallois, maire de Turny.
Une autorégulation de la vitesse
Avec les petits hameaux qui composent la commune, c’est un système de
radar mobile qui a été préféré. Un panneau qui affiche la vitesse à
laquelle roule l’automobiliste sera désormais installé sur les routes de
Turny. Dans le cas où la limitation de vitesse est respectée, un petit
bonhomme affiche un sourire. Dans le cas contraire, c’est une grimace qui
témoigne de l’excès signalé.
Afin d’établir un bilan chiffré, la première semaine, à Bas-Turny,
la vitesse n’était pas affichée. La commune a ainsi pu enregistrer les
vitesses auxquelles roulaient les automobilistes. Sur une portion limitée
à 50 km/h, la majorité roulait alors entre 60 et 70 km/h. Deux
semaines plus tard, après mise en route du système d’affichage, la
moyenne est tombée à 40-50 km/h. « La pédagogie fonctionne »,
se félicite le maire. « Les enfants dans le car scolaire
applaudissent le chauffeur lorsque le panneau affiche le smiley souriant.
Les enfants le comprennent bien et j’espère qu’ils font la même chose
auprès de leurs parents ».
L’effet pédagogique du radar qui ne sanctionne pas durera-t-il ?
C’est-ce qu’espère Stéphane Gallois. Car si les excès de vitesse
recommencent, « nous demanderons à la gendarmerie de venir faire des
contrôles ».
Mathilde Jarlier
___________________________________________________
Le maire de Turny se dit « favorable à l'éolien »

L'Yonne Républicaine du mardi 30 mars 2010
Lors du dernier conseil
municipal le maire de Turny, a évoqué une possible installation d'éoliennes
sur le territoire turrois. Stéphane Gallois répond à nos questions sur le
projet éolien.
Quand avez-vous eu vent de
ces projets éoliens ? On a eu un premier projet, sur les communes de Turny,
Sormery, Neuvy-Sautour, et Lasson, et un autre sur Turny et Venizy, dès fin
octobre 2009. Mais a priori, Venizy serait défavorable à l'éolienne.
Quelle est votre opinion
sur ce projet ? Je suis favorable à l'éolien. Je ne dis pas non d'office.
J'en ai parlé en réunion publique, et au conseil municipal. Il n'y a pas
d'opposition systématique au projet.
Quelles informations
avez-vous sur cette implantation éventuelle d'éoliennes ? Pour l'instant,
on ne sait pas où ils vont les mettre, combien il y en a, et ce que cela va
rapporter à la commune. Nous avons eu deux rendez-vous avec les gens d'Enertrag,
la société qui soutient le projet. Elle sera d'ailleurs présente pour les
rencontres du développement durable, ce week-end à Saint-Florentin.
Qu'est-ce que ce projet
peut amener à la commune ? Aujourd'hui, les ressources des communes sont
faibles. Le projet peut être intéressant si cela ramène de l'argent à la
commune. Si c'est pour le plaisir d'avoir une éolienne, qui rapporte de
l'argent à trois propriétaires terriens, c'est non.
Comment comptez-vous récupérer
cet argent ? Actuellement, si les communes ne touchent pas de royalties, il
n'y a pas d'éolien. Or, c'est une volonté de l'État. Il y aura peut-être,
d'ici là, une taxe spécifique pour l'éolien, qui remplacera la taxe
professionnelle. Mais le temps que le projet avance, que les études soient
faites, le conseil municipal aura le temps de dire non. En même temps, je
préfère les avoir sur le territoire de la commune que de les voir chez le
voisin. Sinon, on aura la vue et le bruit des éoliennes mais on ne touchera
rien.
Lors des réunions
publiques ou au conseil, y a-t-il eu des oppositions marquées au projet ?
Il y a seulement une habitante qui était franchement contre le projet.
Ensuite, si des habitants sont contre, ils pourront le dire lors de l'enquête
publique.
Dans d'autres communes,
des associations de citoyens se sont mobilisées contre les éoliennes,
craignez-vous que cela arrive à Turny ? Non, je ne le crains pas. Je trouve
bien qu'il y ait de l'opposition, c'est sain. Par contre, le projet ne doit
être arrêté que s'il a un impact négatif sur la santé ou
l'environnement.
L'implantation d'éolienne
est-elle inévitable, selon vous ? Les gens veulent consommer de l'électricité
mais ils ne veulent pas de centrale nucléaire, pas d'éoliennes, ce n'est
pas possible. C'est pareil pour l'enfouissement des déchets. Celui qui ne
veut pas de centre d'enfouissement ne met pas ses poubelles sur le pas de sa
porte.
Jeudi 3 février 2011
Jeudi soir, de nombreux habitants de Turny
s'étaient déplacés à la salle des fêtes, pour assister à une réunion
d'information sur le projet éolien déposé par Enertrag, spécialiste
des énergies renouvelables.

L'éolien s'intéresse aux communes de Turny, Lasson, Sormery et
Neuvy-Sautour.
« Nous avons reçu, depuis novembre 2009, plusieurs projets
éoliens. Les deux premiers émanaient de Volswind. Nous les avons écartés.
Un troisième nous est proposé par Enertrag. Il mérite d'être étudié.
Nous en avons débattu au conseil municipal et décision a été prise de
proposer cette réunion », expliquait Stéphane Gallois, maire de
Turny, jeudi soir, à l'occasion d'une réunion d'information sur les
projets éoliens. Une réunion publique à laquelle participaient
notamment les maires de Lasson et Sormery ainsi qu'un élu de
Neuvy-Sautour.
Un exposé complet a permis au public de connaître la démarche longue
et complexe (6 ans environ) qui sépare la demande de projet de sa réalisation.
Tout doit commencer par la création d'une Zone de développement éolien
(ZDE) déposé par la collectivité. Le dossier est élaboré par le
bureau d'études choisi par celle-ci. Il y a enquête publique et le préfet
prend la décision finale qui peut être contestée, en dernier ressort,
au tribunal administratif.
De nombreux éléments sont pris en compte : la sécurité, le
bien-être de la population, la biodiversité, l'impact sur le paysage et
le patrimoine. Légalement les éoliennes ne peuvent être implantées à
moins de 500 m des habitations. Pour la commune, ce serait 800 m.
Deux à quatre éoliennes sur Turny
Le projet sur les quatre communes consisterait en l'implantation de 8
à 16 éoliennes, dont 2 à 4 pour Turny. Celles-ci seraient situées
entre Saudurant et Courchamp. Le maire conclut en expliquant les avantages
financiers que la commune pourrait tirer d'une telle réalisation :
40.000 euros annuels : « ce qui
correspond à la somme nécessaire à la rénovation de nos écoles ».
Un débat s'en est suivi où les opposants à l'éolien ont fait
entendre leurs arguments.
Une
réunion publique d'information se tiendra le 3 février 2011
Le sujet sera à l'ordre du jour du conseil municipal, le 17 février
2011, et le Conseil
Municipal rend un avis favorable pour l'installation d'éoliennes à TURNY.
P. T.
Le collectif, « À bout de
vents », conteste le projet d'implantation d'éoliennes
jeudi 22
septembre 2011
Neuvy-Sautour (Yonne) - Un
projet d'implantation de 16 éoliennes a fait réagir quelques habitants
des communes concernées : Lasson, Neuvy-Sautour, Sormery et Turny. L'étude
de la ZDE (zone de développement éolien) a été acceptée par les
conseils municipaux. Des habitants, souhaitant en savoir plus, se sont réunis
en association et ont essayé de chercher des informations afin de se
faire une idée sur les conséquences d'une telle implantation. Ils
organisent vendredi 23 septembre, à 20 h à la salle des fêtes de Turny,
une réunion pour communiquer leur étude. Robin Millet, président de
cette association À bout de vents précise que ses membres ne sont pas
anti-éoliens mais qu'ils cherchent à se documenter et sont réalistes.
le collectif « A bout de vents » organise, le 23 septembre
2011 à 20h à la salle des fêtes de Turny, une première réunion
publique pour mettre la population en garde. Il s'oppose au projet de création
d'une zone de développement de l'éolien (ZDE).

Joël Mercadal, secrétaire du collectif.
Site Internet http://aboutdevents.net/
Photo Marie.coreixas
Ils n'ont rien contre les éoliennes. C'est le premier message des
membres de ce collectif, « À bout de vents », fondé au
lendemain des votes, en février dernier, de Turny, Lasson, Neuvy-Sautour
et Sormery en faveur du lancement d'une étude préalable au projet d'une
zone de développement de l'éolien (ZDE). Mais tout de même. Ce groupe
d'une quarantaine de personnes, qui se veut avant tout écologiste,
souhaite que l'on se pose les bonnes questions.
« On ne nous parle que d'argent »
« On nous a avant tout parlé d'argent. Celui que ça
rapporterait aux entrepreneurs, aux communes Et l'écologie dans tout ca ? »,
s'inquiète Joël Mercadal, secrétaire du collectif.
Et l'association a beau ne pas être contre l'éolien, « À bout
de vents » n'en a pas moins dressé un vrai plaidoyer contre cette
éventuelle ZDE, sur laquelle la société allemande Enertrag se verrait
bien poser 6 à 16 éoliennes.
« Nous avons consulté la carte des vents, nous nous situons sur
une zone de vents faibles. Alors, pourquoi ce projet, qui plus est si près
de la forêt d'Othe, un périmètre à forte sensibilité paysagère ? »,
s'interroge Joël Mercadal. Et ce n'est pas tout. Le collectif s'inquiète
également de l'impact de l'implantation de ces géantes, d'une centaine
de mètres de hauteur, sur la faune et la flore. En l'occurrence, sur les
grues, dont le couloir de migration, d'après les cartes de l'ADEME,
traverse l'éventuelle ZDE de part en part. « Un projet d'éoliennes
a avorté en Champagne-Ardennes à cause de cela. Et aujourd'hui, on veut
en créer un nouveau, à trois kilomètres de la frontière ? »
Ces questions-là et toute une litanie de nuisances potentielles sur la
santé, l'environnement, l'habitat, le collectif s'est donné pour mission
de les exposer à un large public. Tout d'abord, en organisant une première
réunion, ce soir. « Les habitants sont partagés sur ce projet,
estime le secrétaire. Chacun prêche pour sa paroisse. »
À commencer par « À bout de vents », à en croire Stéphane
Gallois, maire de Turny. « Ils disent non avant de savoir. Ni moi,
ni la société exploitante ne connaissons la force du vent ou l'impact
environnemental, car les études n'ont même pas commencé. Cette réunion
? Le conseil municipal leur a permis de la tenir, en prêtant la salle
gratuitement, mais j'espère que les pro-éoliens aussi, seront dans les
rangs. »
Une
réunion du conseil municipal du 29 septembre 2011 met ce point à l'ordre
du jour
À bout de vents informe sur l'éolien (l'Est
Eclair 30/09/2011)
À bout de vents a organisé une réunion
d'information sur le projet de création d'une zone de développement
éolien
Turny (Yonne) - Le projet
d'implantation d'éoliennes sur les communes de Lasson, Neuve-Sautour,
Sormery, Turny - dont la zone de développement de l'éolien (ZDE) a été
votée par les conseils municipaux - a poussé des habitants de ces
villages à se documenter sur les avantages et les inconvénients d'un
tel projet.
Une réunion à Turny de
l'association À bouts de vents, créée à cette occasion, a rassemblé
150 personnes qui ont pu apprécier la qualité des exposés et de la
documentation.
Tout d'abord, l'exposé
intitulé « Paysages, patrimoine, territoire » a permis de mettre en
avant les inquiétudes portant sur la proximité de la ZDE avec trois églises
classées et une inscrite à l'Inventaire des Monuments historiques,
avec l'emplacement d'une maison templière déjà signalée en 1254, et
ceux d'enclos circulaires et de nécropoles identifiés, tout comme avec
des vestiges protohistoriques.
Une présentation illustrée sur la faune a souligné le comportement
des oiseaux migrateurs qui empruntent le couloir passant par cette ZDE
deux fois par an.
Enfin, l'assemblée s'est vu présenter un montage financier concernant
les différents bénéficiaires - collectivités, agriculteurs et résidents.
Le débat a été enrichi par l'évocation du travail de recherche de
deux médecins sur le traitement de l'éolien dans de nombreux pays. Gérard
Henry, ancien magistrat, et Raymond Hardy, ancien maire de Tonnerre,
tout comme des membres du public ont apporté des compléments
d'information. Le président d'À bouts de vents Robin Millet peut se féliciter
du travail accompli, quand bien même la démarche d'information ne fait
que commencer.
L'association
s'oppose au projet de création d'une zone de développement de l'éolien
sur les communes de Turny, Lasson, Neuvy-Sautour et Sormery.

L'Yonne Républicaine du 23 janvier 2012
Ce ne sont que les prémices d'un projet d'implantations d'éoliennes.
Mais l'association À Bout de vents ne veut pas attendre davantage
pour monter au créneau. Elle s'active depuis l'année dernière pour
tenter de contrer l'implantation de 6 à 16 structures sur les
communes de Turny, Lasson, Neuvy-Sautour et Sormery.
« Nous n'avons rien contre les éoliennes mais ce projet se
fait en dépit du bon sens, estime Joël Mercadal, le secrétaire de
l'association. Nous sommes dans une des régions les moins ventées de
France. Ce projet ne sera pas rentable. »
Cet habitant de Turny regrette par ailleurs « un manque de
concertation. Le projet semble nous être imposé. Les communes y
voient un moyen de gagner de l'argent mais ne prennent pas en compte
certains problèmes. »
L'association, qui a vu le jour en février 2011 et revendique
plus d'une centaine d'adhérents, a exposé ses craintes vendredi lors
d'un débat organisé à Neuvy-Sautour. La réunion a fait salle
comble. « Au début, les habitants n'étaient pas conscients du
problème. Aujourd'hui, ils commencent à y être sensibilisés. Notre
but est de faire prendre conscience que les éoliennes n'ont pas de
raison d'être chez nous. Nous souhaitons instaurer le débat, sans être
agressifs. »
Contrairement à d'autres débats organisés sur le même sujet
ailleurs dans le département, celui proposé vendredi soir s'est, en
effet, déroulé dans le plus grand calme.
Devant une centaine de personnes environ, les membres de
l'association ont développé leurs arguments. « Nous ne sommes
pas des opposants farouches à l'éolien mais des citoyens
responsables qui refusons le manque de transparence concernant le
montage de ce projet, les informations incohérentes qui nous sont
données et la crainte d'être mis devant un fait accompli irréversible
et destructeur pour l'environnement », a lancé en préambule
Robin Milett, le président de l'association.
Tour à tour, les membres d'À Bout de vents sont venus présenter
leurs arguments, à commencer par celui du vent. Selon les mesures
qu'ils se sont procurées, les quatre villages concernés par ce
projet seraient situés dans une zone de vent faible. Ils ont chiffré
qu'avec un vent d'environ six mètres\seconde, les éoliennes ne
produiraient qu'à peine un cinquième de leur puissance nominale.
L'association dénonce ainsi l'inefficacité énergétique du projet
et exige un droit de regard sur les mesures de vent qui seront effectuées.
Dans le couloir de migration des grues
À Bout de vents estime également que la valeur des biens
immobiliers baisserait de 20 à 30 %. « C'est ce qui s'est
passé partout ailleurs. »
Les opposants considèrent enfin que les aérogénérateurs
constituent une atteinte grave à la biodiversité. « Rapaces et
chauves-souris sont souvent victimes des pâles de ces machines »,
ont-ils rappelé. Par ailleurs, les engins, dont la hauteur est estimée
à près de 150 mètres, se trouveraient dans le couloir principal de
migration de nombreuses espèces et particulièrement des grues cendrées,
espèce protégée depuis 1976.
Denis Melmi, médecin exerçant à Saint-Florentin, est venu parler
des risques pour la santé. Selon lui, le « syndrome éolien »
généré par le bruit des machines et les infrasons est une réalité.
Il a rappelé que l'Académie de médecine préconisait une distance
d'au moins 1.500 mètres entre les éoliennes et les habitations et
que le principe de précaution devait s'appliquer.
Les spectateurs ont eu droit à la projection d'un petit film. Les
habitants d'un village d'Auvergne, cerné par des éoliennes, ont témoigné
devant la caméra. À les en croire, les éoliennes apparaissent comme
des voisines très envahissantes.
À Bout de vents n'entend pas relâcher la pression : elle
programmera dans les prochaines semaines une nouvelle réunion
publique à Sormery.
Marc Charasson
et Christophe Crauland
__________________________________________________________________
« Les Gavroches » en vacances à Turny L'Yonne Républicaine du
Vendredi 29 juillet 2011

Après Neuvy-Sautour, la commune de Turny héberge dans sa salle des
fêtes, depuis le 18 juillet, une antenne des Centres de loisirs
« Les Gavroches ».
De 7 h 30 à 18 h 30, Aline, Marie-Astrid et Marjorie accueillent 24
enfants de 3 à 11 ans venus de Turny et des villages environnants.
Aline, la responsable, explique : « Nous proposons de larges
horaires d'ouverture car de nombreux parents travaillent. De 7 h 30 à 9
h 30, nous procédons à l'accueil. Nos activités ne débutent réellement
qu'à 9 h 30 et se poursuivent jusqu'à 17 heures. Ensuite, nous
accueillons les parents jusqu'à 18 h 30. À midi, les enfants prennent
le repas qui leur est servi, sur place ».
Les activités proposées sont variées et s'articulent autour d'un
thème qui change pratiquement toutes les semaines. Elles sont adaptées
à l'âge des participants ; il y a ainsi le groupe des petits et celui
des grands. Début juillet, avec le thème « Danse et son »,
les enfants ont découvert la guitare et la batterie. Ils ont créé bâton
de pluie, maracas ou tam-tam africain...
Retrouvez la suite de cet article dans l'édition
du 30 juillet 2011 de l'Yonne Républicaine
Patrick Tapin
L’espace sportif familial sera
prêt fin 2012 (YR18/04/12)

L’espace sportif familial sera
aménagé au lieu-dit des Maraults, à l’emplacement d’un ancien
terrain de football.
Le conseil municipal de Turny s'est réuni et a fait le point sur les
projets d'investissement de la commune, à travers l'adoption du budget
primitif 2012. Les contribuables peuvent se réjouir : il n'y aura pas
d'augmentation des impôts communaux pour 2012. Les projets
d'investissement n'en pâtiront pas pour autant.
Un cabinet médical aménagé par la commune
Deux d'entre eux ont déjà été réalisés. Le premier est l'aménagement
du local qui accueille le cabinet médical. Son coût s'élève à
38.500 €. La commune a reçu une subvention
de 17.500 € sur la réserve parlementaire du
député Jean-Marie Rolland. Le second est l'amélioration d'un logement
locatif, pour un montant de 8.000 €.
D'autres projets sont en cours, à différents niveaux d'avancement.
Agrandissement du cimétière
Celui du « terrain espace sportif familial » des Maraults
est en bonne voie. Circuit de vélo de cross, terrain multisports,
parcours de santé, terrain de foot et parking devraient donc être opérationnels
avant la fin de l'année.
Le coût des travaux sera financé par la commune à hauteur de
76.000 € et par le conseil régional, à
hauteur de 12 000 €, par le conseil général,
à hauteur de 15 000 €, dans le cadre du «
Contrat de canton ». Enfin, 28.000 € seront
alloués au projet par l'Etat, au titre de la Dotation d'équipement des
territoires ruraux.
Par ailleurs, l'agrandissement du cimetière est déjà budgété,
pour un montant de 110.000 €. Celui-ci ne bénéficiera
d'aucune subvention et sera financé par un emprunt.
Les travaux nécessaires de rénovation du chauffage de la salle des
fêtes sont également inscrits au budget. Le dossier est pour l'heure
entre les mains d'un thermicien



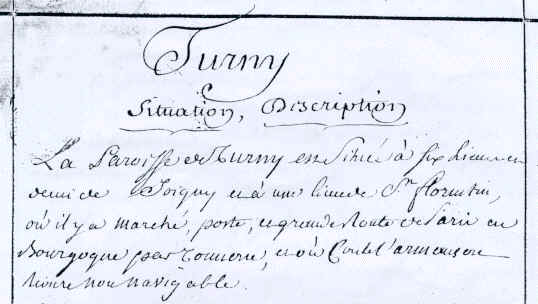


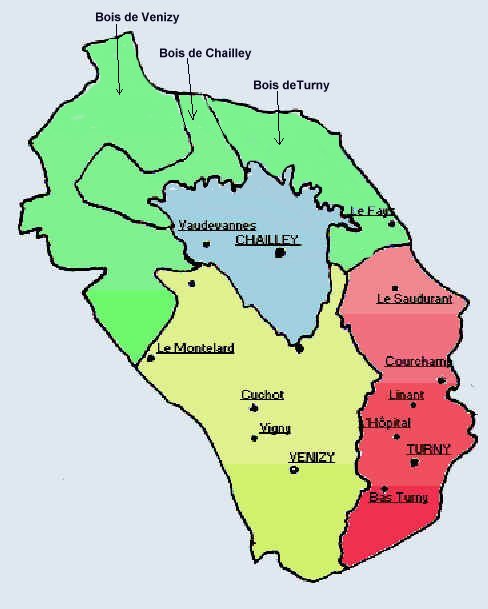
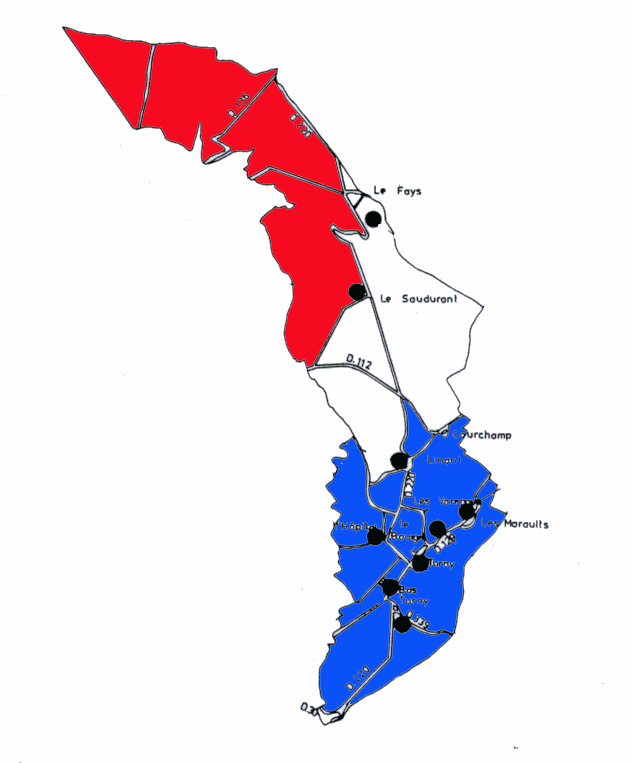
 Les organisateurs, membres du Comité de développement du pays d’Othe, se
disaient ravis du déroulement de la quatorzième édition de la Fête du cidre,
hier, à Turny. Un peu plus de 1 000 entrées ont été comptabilisées
en milieu d’après-midi, et cette ambiance conviviale propre à la fête
tournante a été unanimement louée.
Les organisateurs, membres du Comité de développement du pays d’Othe, se
disaient ravis du déroulement de la quatorzième édition de la Fête du cidre,
hier, à Turny. Un peu plus de 1 000 entrées ont été comptabilisées
en milieu d’après-midi, et cette ambiance conviviale propre à la fête
tournante a été unanimement louée.